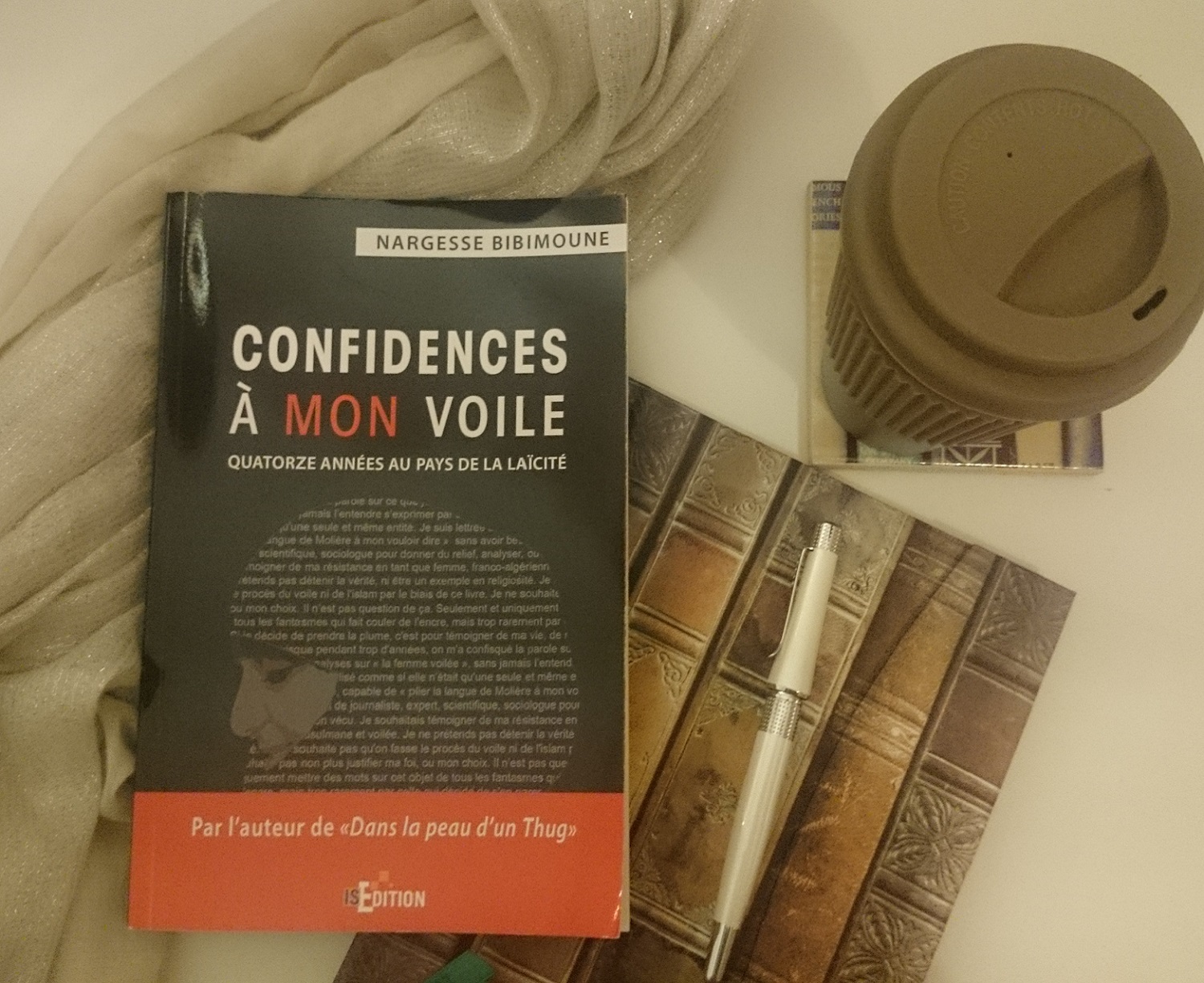En juin 2023, Aïcha, une enfant noire âgée de 13 ans est décédée à l’hôpital des suites d’une hémorragie cérébrale. Tout aurait dû être fait pour éviter sa mort. Dimanche 3 décembre, Médiapart a publié une enquête sur les évènements qui ont mené à...







![[Communiqué] Lallab s’élève contre l’amendement voté au Sénat contre le port du voile des mères lors des sorties scolaires](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2019/05/Sans-titre-2.png)




![[Communiqué] Harcèlement des femmes musulmanes dans l’espace public : on dit stop !](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2017/03/Sarahz.png)