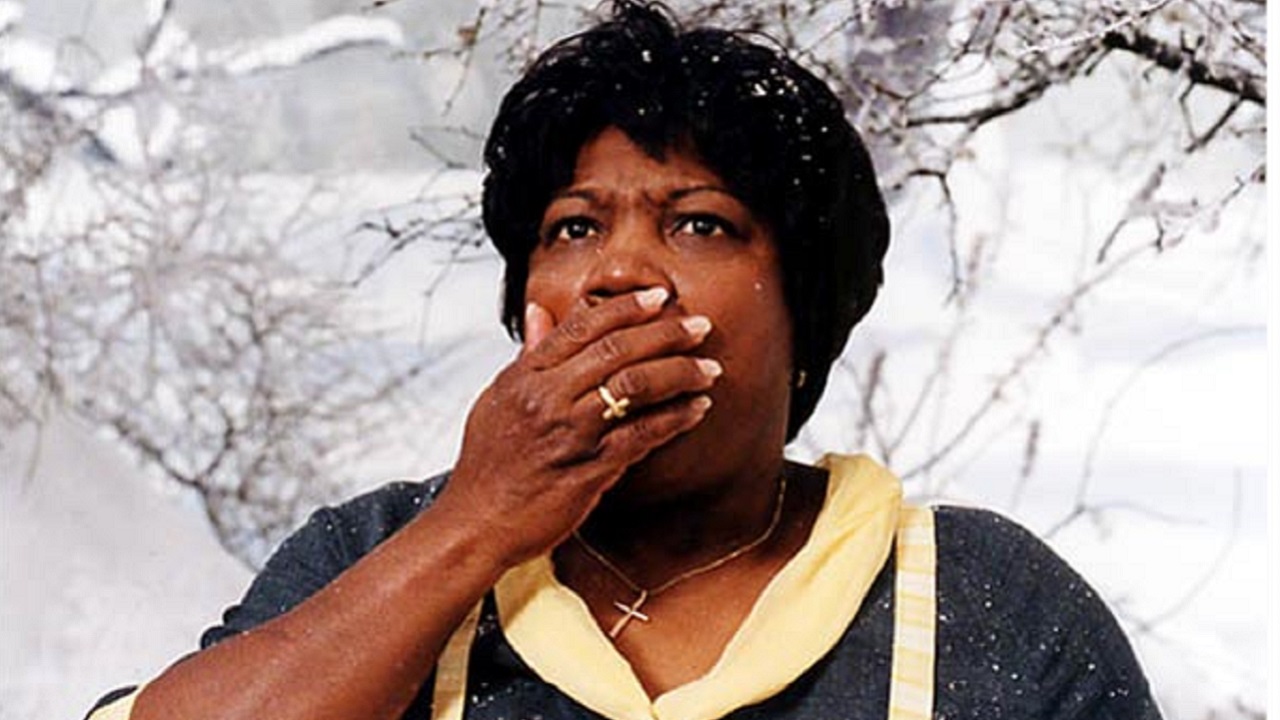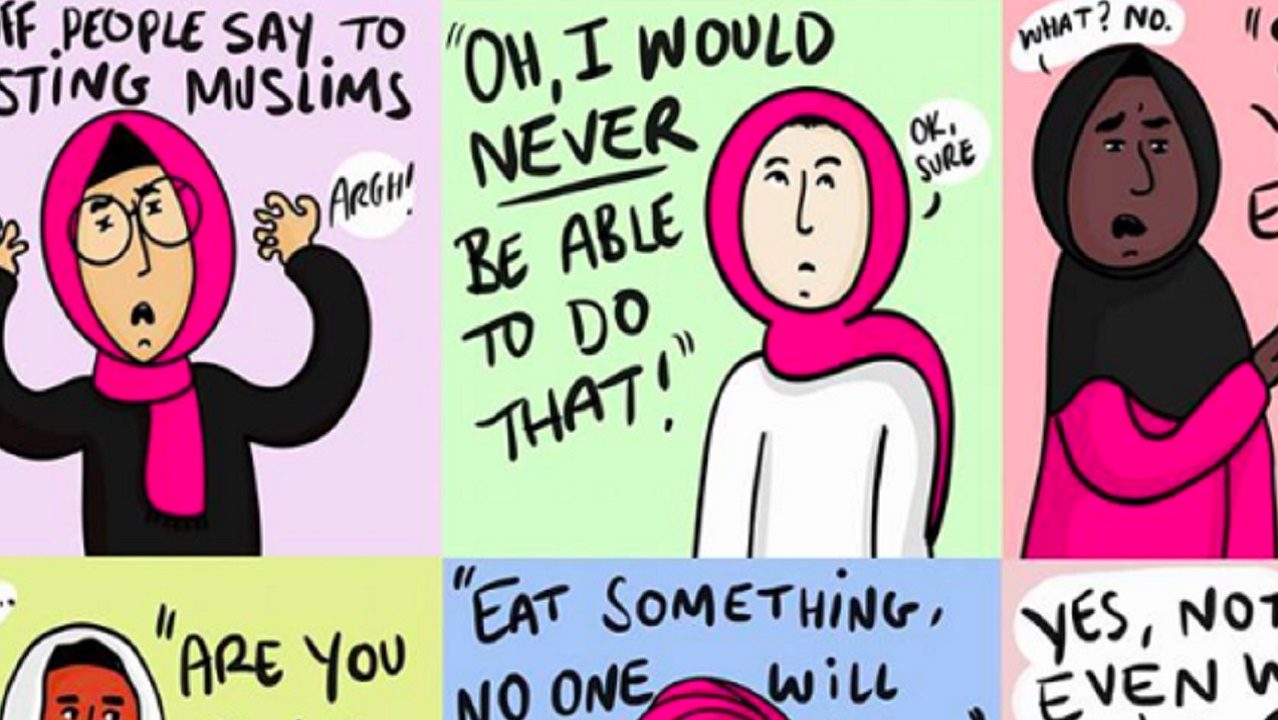Les articles écrits par
Emnus
L'Emnus Lallabus est un croisement rare entre des espèces venant d'Afrique du Nord et d'Europe de l'Est. Son régime alimentaire est caractérisé par une consommation excessive de chocolat. Ses signes distinctifs : tendance compulsive à faire des listes, bilingue en sarcasme, affection particulière pour les films moldaves sous-titrés en norvégien.