En cette période d’élections législatives, avec l’extrême droite aux portes du pouvoir, il est crucial pour Lallab de donner la parole aux femmes musulmanes, principales impactées. La lutte passe par le vote (dimanche 30 juin et dimanche 7 juillet) et l’auto-organisation, et s’auto-organiser commence par le partage de nos récits. Célia, Myriam, Sarah et Chaïma, bénévoles à Lallab, partagent leurs ressentis, leurs craintes et leurs espoirs.
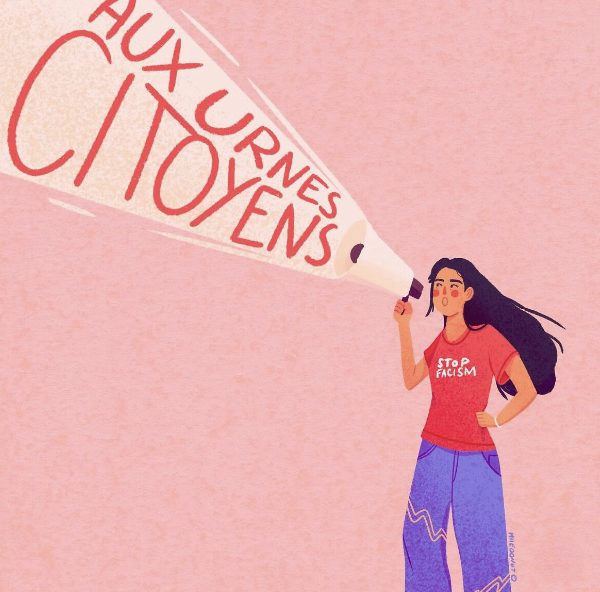

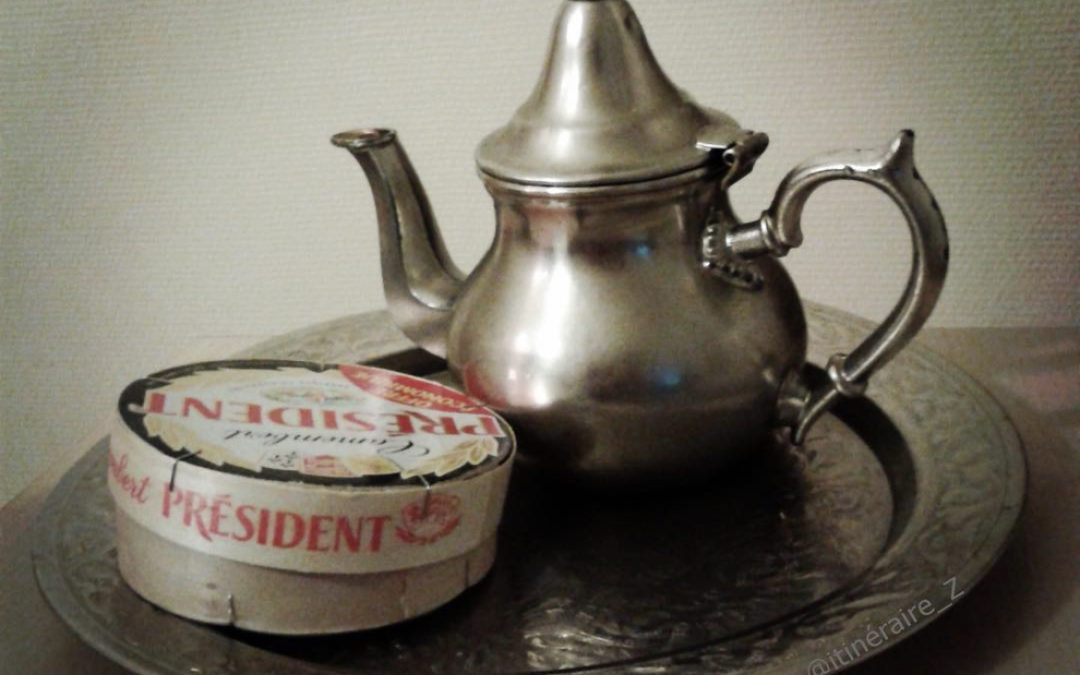
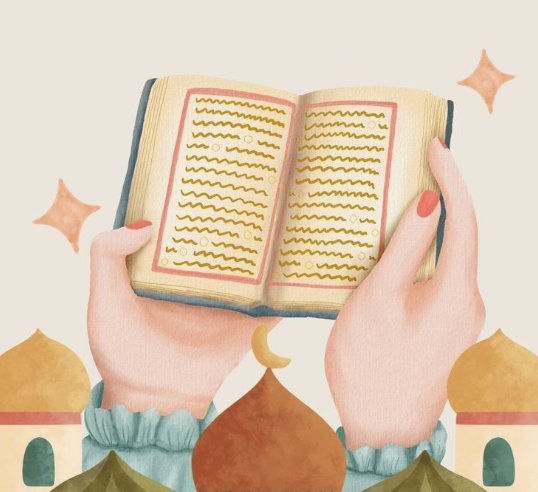

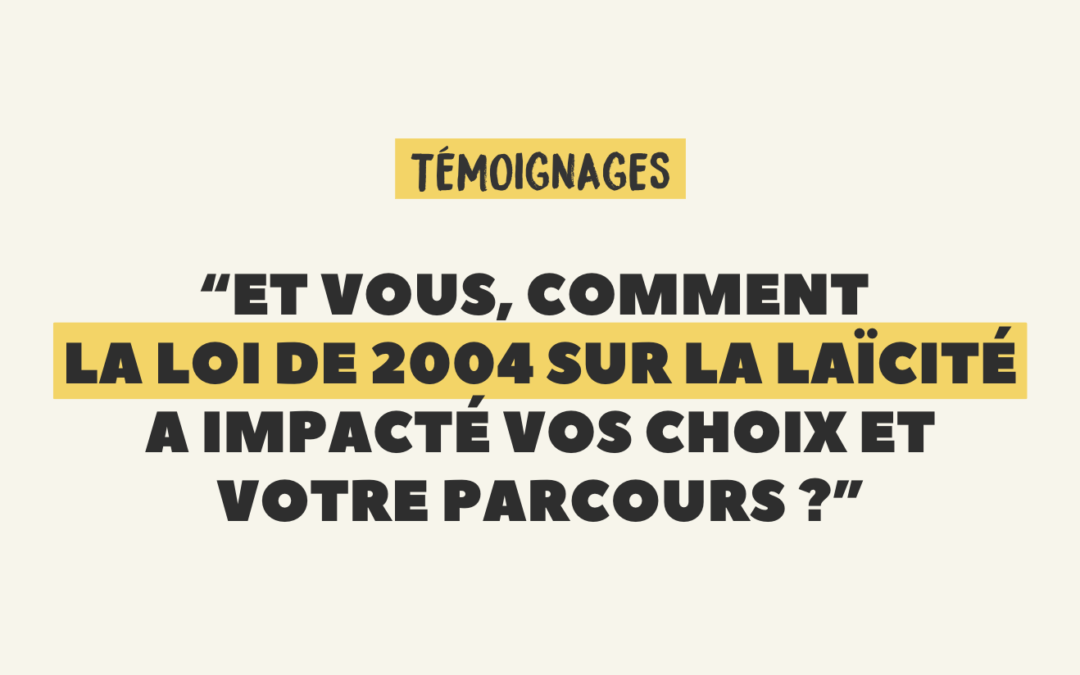
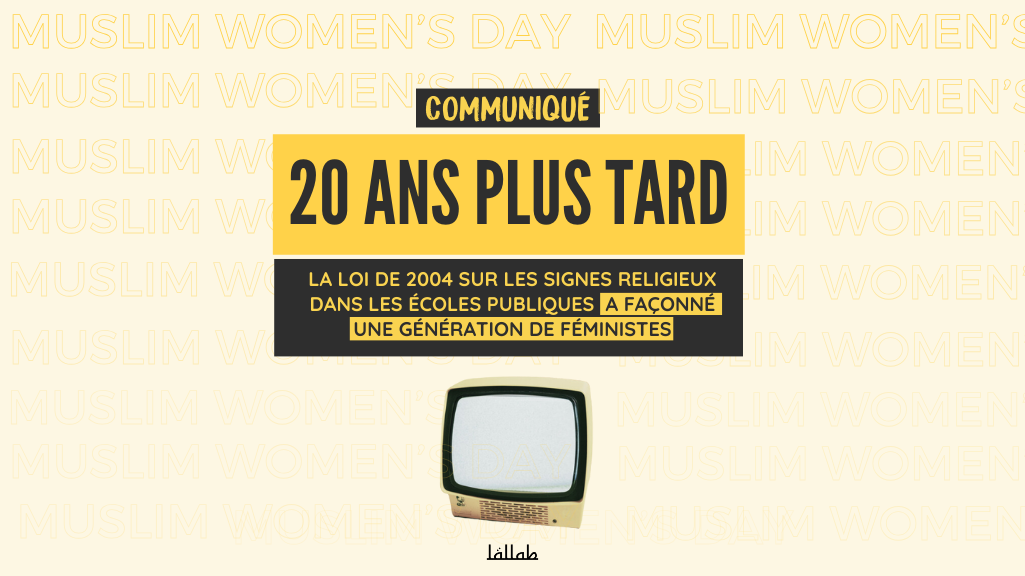
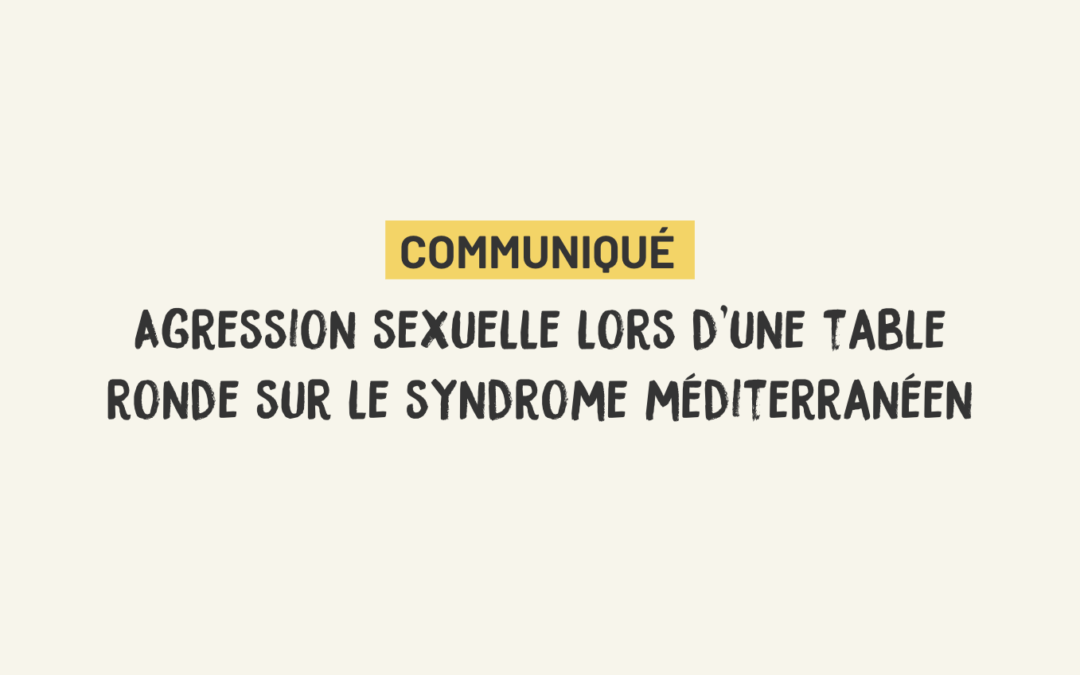







![[Communiqué] 8 mars 2020 : « Nous sommes fatiguées »](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2020/09/Village-des-féminismes-2-magazine.jpg)