Pour sa 7e édition du Muslim Women’s Day (MWD), Lallab mettra à l’honneur les 20 années d’engagement féministe pour les droits et les libertés, qui ont suivi la promulgation de la loi de 2004 sur le signes religieux dans les écoles publiques.
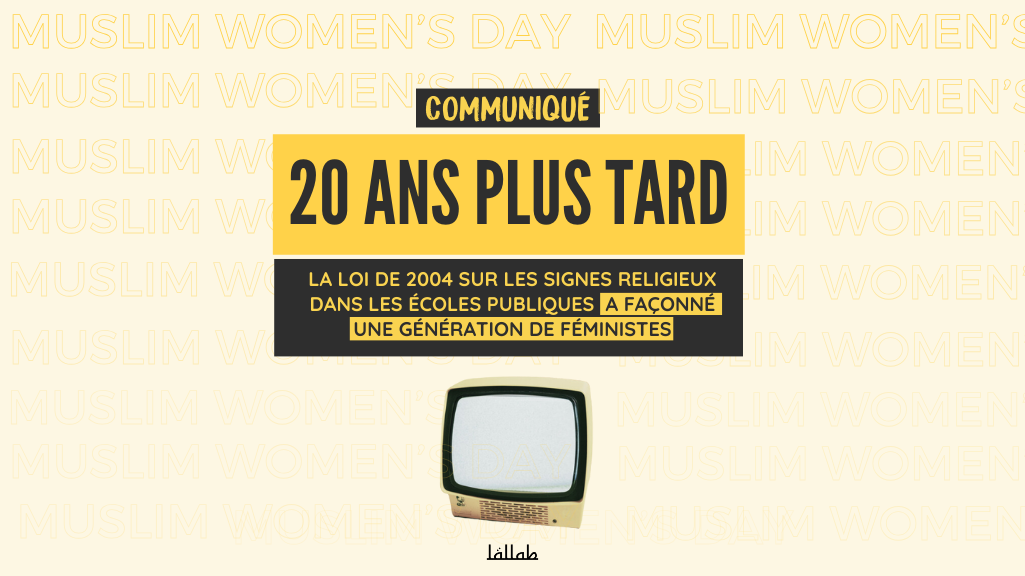
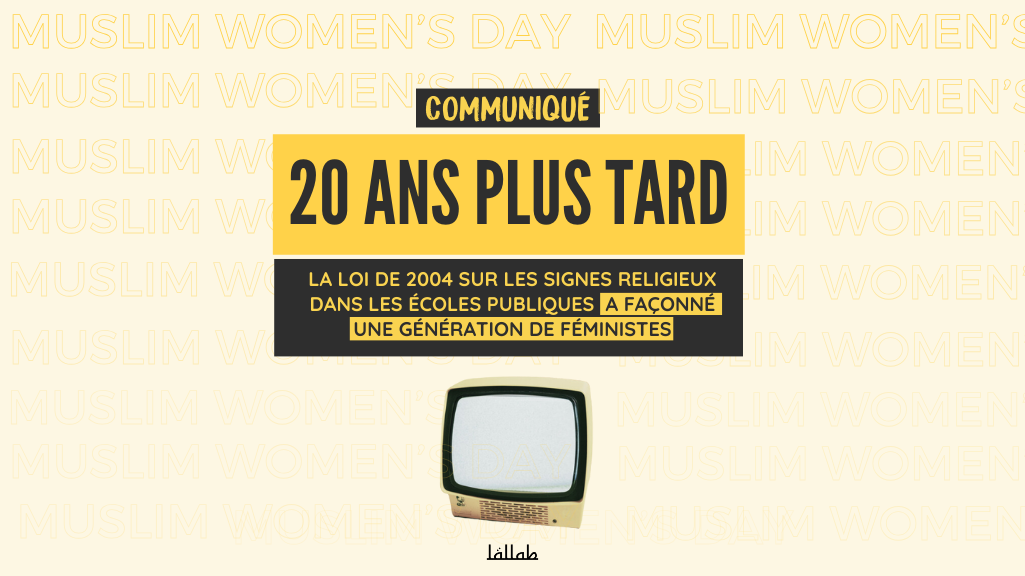
Pour sa 7e édition du Muslim Women’s Day (MWD), Lallab mettra à l’honneur les 20 années d’engagement féministe pour les droits et les libertés, qui ont suivi la promulgation de la loi de 2004 sur le signes religieux dans les écoles publiques.
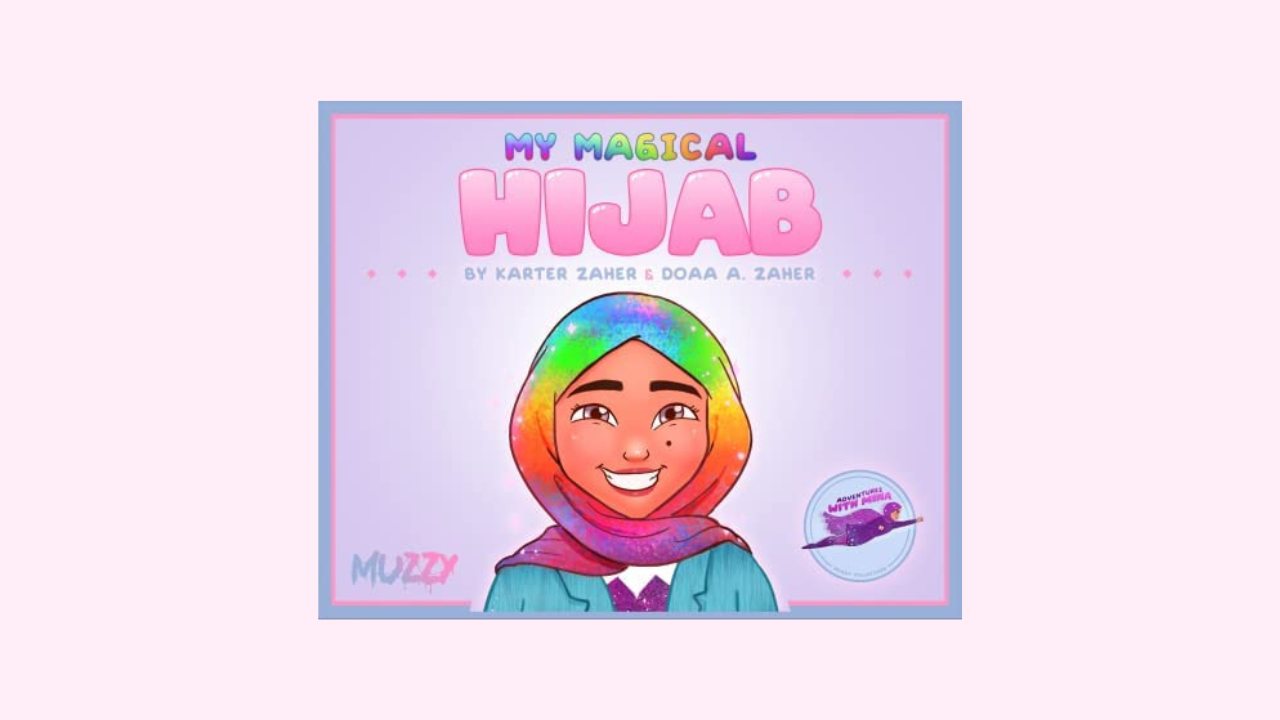
Les aventures de Mina – My Magical Hijab My Magical Hijab est un livre pour enfants. On suit les aventures et le quotidien de Mina - personnage principal plein de vie et d’énergie. L’histoire commence le jour de son anniversaire où sa mère lui...

Comment faire (re)naître la présence des femmes dans le monde du digital en Ile-de-France J’ai eu l’occasion de connaître Mouna Jabri, jeune femme inspirante de 26 ans, par le biais de mon entourage. Tout, chez elle, m'a intriguée : son...

Plusieurs footballeuses professionnelles ou amatrices se sont regroupées au sein de la campagne « Les Hijabeuses » afin d’avoir le droit de pratiquer leur sport avec leur foulard. En effet, la FFF interdit toujours aux joueuses de le porter pendant...
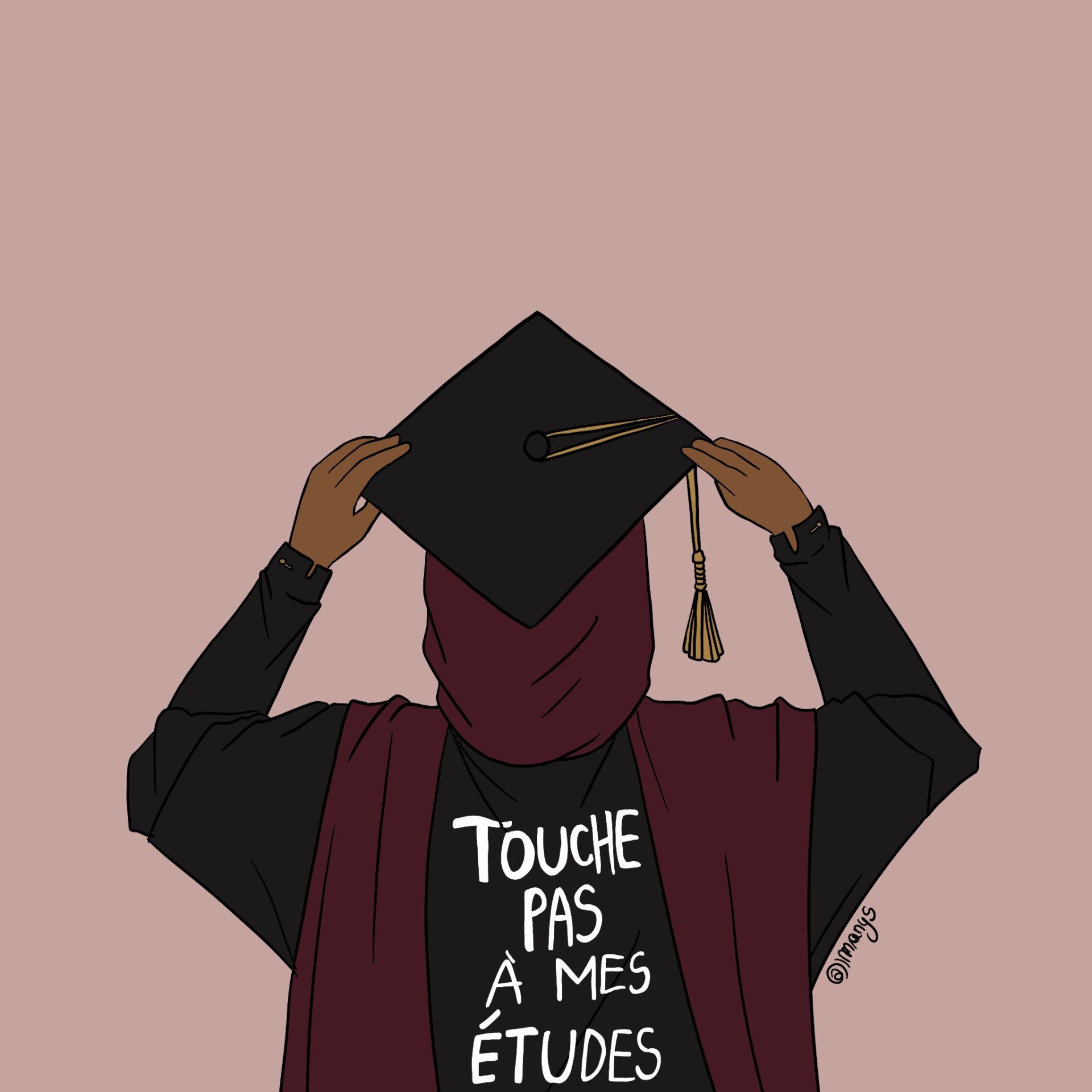
Dans le cadre du dossier sur le récit de lutte des étudiantes musulmanes en Belgique, une série d’entretiens consacrés aux partages d’expérience de collectifs, ayant initié et/ou participé au mouvement #HijabisFightBack, a été réalisée au mois de...
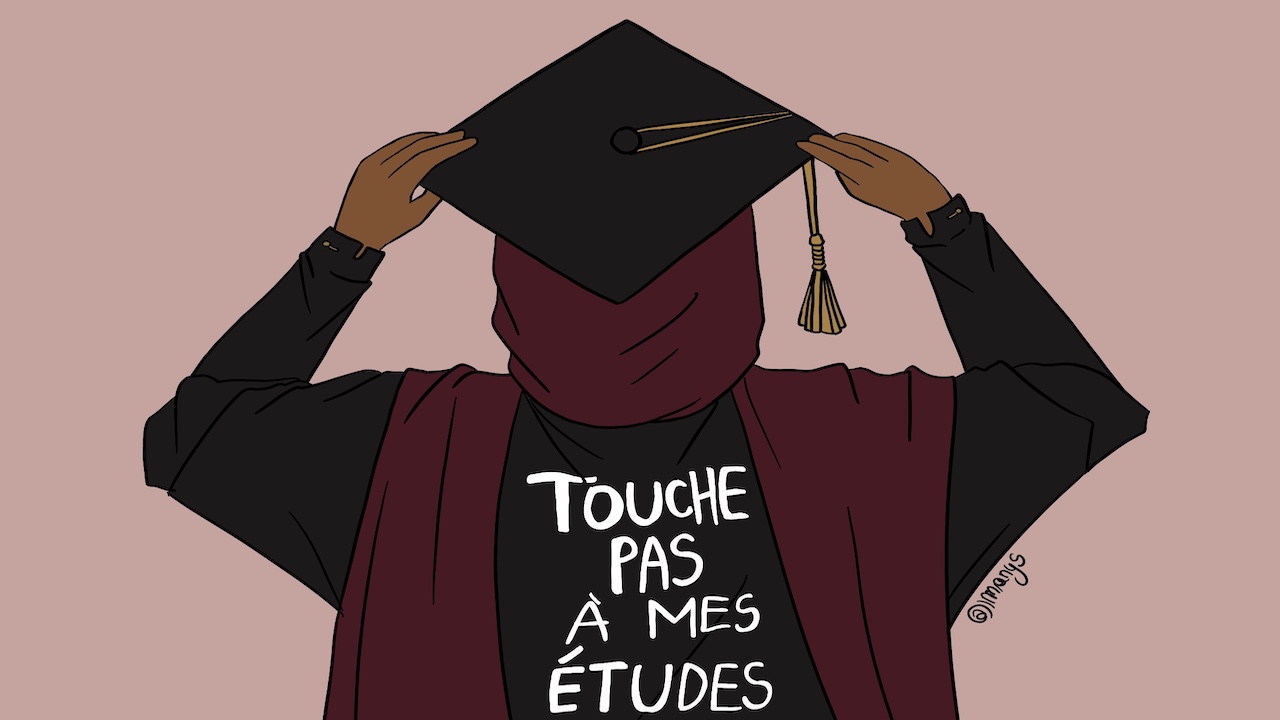
Dans le cadre du dossier sur le récit de lutte des étudiantes musulmanes en Belgique, une série d’entretiens consacrés aux partages d’expérience de collectifs ayant initié et/ou participé au mouvement #HijabisFightBack, a été réalisée au mois de...
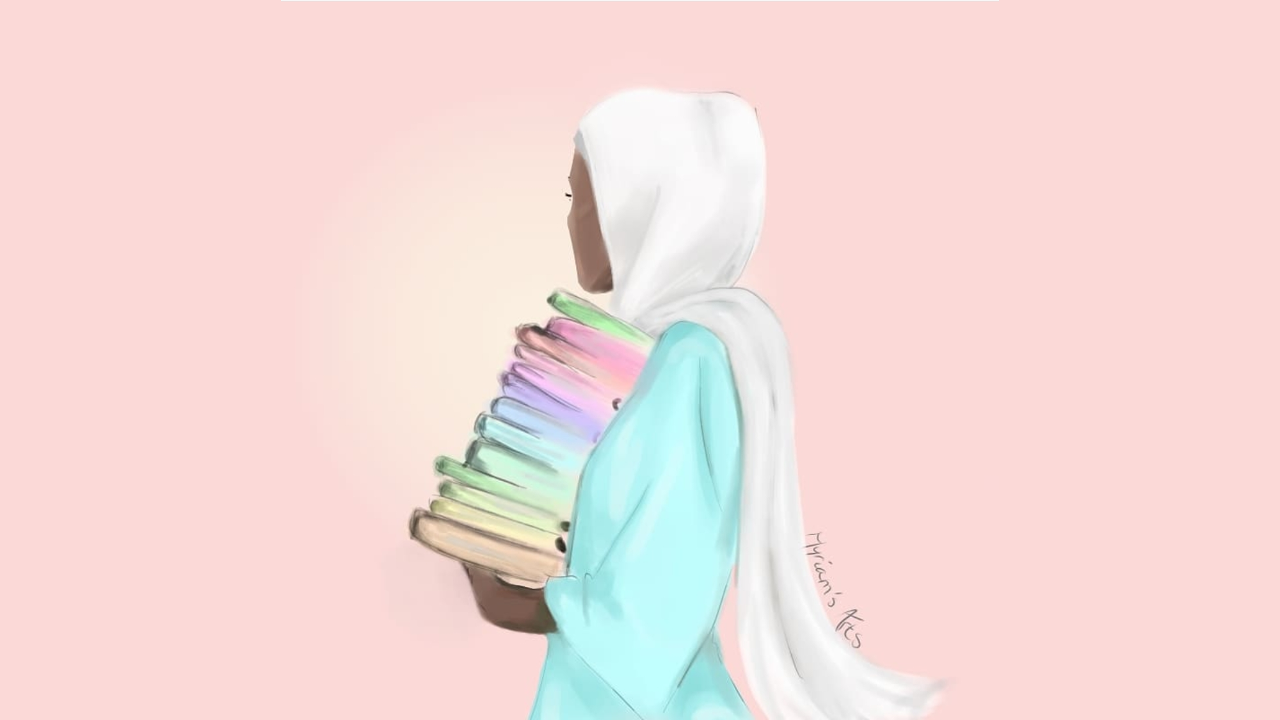
Le 4 juin 2020, la Cour constitutionnelle autorise l’interdiction du port des signes convictionnels dans les établissements d'enseignement supérieur en Belgique. Une décision de justice accueillie avec «mécontentement et surtout incompréhension »...
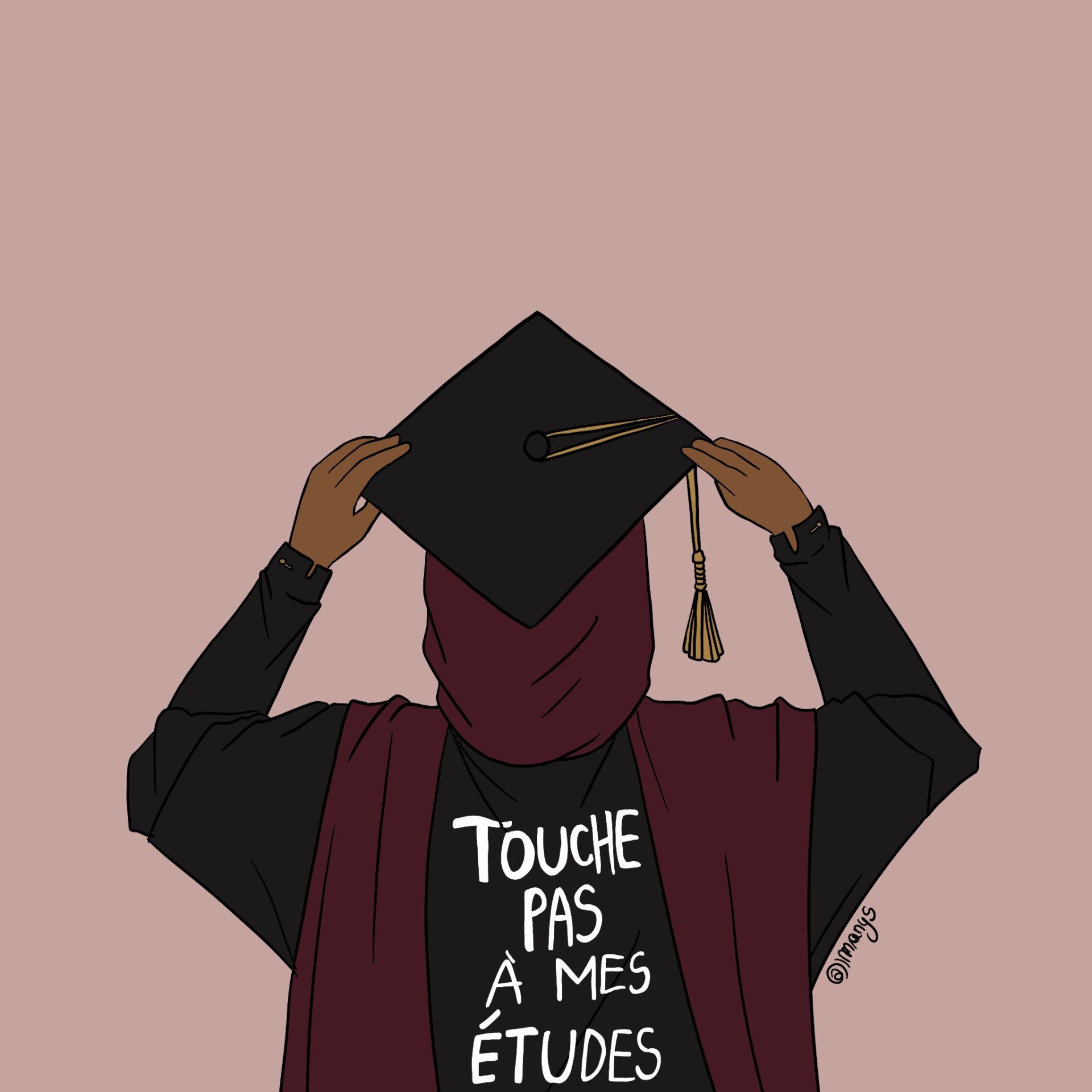
Dans le cadre du dossier sur le récit de lutte des étudiantes musulmanes en Belgique, une série d’entretiens consacrés aux partages d’expérience de collectifs ayant initié et/ou participé au mouvement #HijabisFightBack a été réalisée au mois de...

Je m’appelle Déborah, je suis française, musulmane et il y a quelques jours, j’ai retiré mon voile. Ce pays a eu raison de mes libertés, de mes envies et de mes choix. Après 5 ans de bons et loyaux services, j’ai décidé il y a quelques jours...
![[Communiqué] Agression sexiste et islamophobe au Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté : notre soutien aux victimes est total](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2019/10/Lallab-femme-conseil-régional-bourgogne..jpg)
Ces derniers jours ont été extrêmement douloureux pour nous, membres de Lallab. Nous avons assisté, atterrées, abattues et horrifiées, à l'épisode tragique de cette mère, qui porte le voile, et qui s'est retrouvée prise à partie et agressée par un...

“C'est vraiment dommage vous avez un bon profil, mais le voile n’est pas toléré au sein de notre entreprise.” Étudiante, j'étais à la recherche d'un job étudiant qui me permettrait d'arrondir mes fins de mois. J'ai donc postulé à plusieurs...
![[Communiqué] Ilhan Omar nous sommes à tes côtés !](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2019/05/Sans-titre-3.png)
#StandWithIlhan Ilhan Omar est l’une des premières femmes musulmanes élue au congrès des Etats-Unis. Arrivée à l’âge de 8 ans avec sa famille aux Etats-Unis pour fuir la guerre civile de Somalie, son ascension politique est l'emblème même...

Un jour, j’ai fait un rêve étrange. Un rêve utopiste. Ce rêve va vous paraître ordinaire. Mais faut croire que j’ai des rêves assez simples. J’ai fait le rêve que je travaillais dans une entreprise bienveillante où le fait d’être une femme, racisée...

À l’occasion du Muslim Women’s Day, il est important d’aborder la relation ambiguë que l’on peut entretenir avec l’institution scolaire et notamment en tant que mère. Cette relation est constituée d’une grande part d’appréhension face au...

A l’occasion du Muslim Women’s Day, la journée internationale des femmes musulmanes de 27 mars, Lallab a lancé un appel à témoignages afin de récolter vos histoires de femmes musulmanes sur vos expériences, sur les discriminations et les violences...