En cette période d’élections législatives, avec l’extrême droite aux portes du pouvoir, il est crucial pour Lallab de donner la parole aux femmes musulmanes, principales impactées. La lutte passe par le vote (dimanche 30 juin et dimanche 7 juillet) et l’auto-organisation, et s’auto-organiser commence par le partage de nos récits. Célia, Myriam, Sarah et Chaïma, bénévoles à Lallab, partagent leurs ressentis, leurs craintes et leurs espoirs.
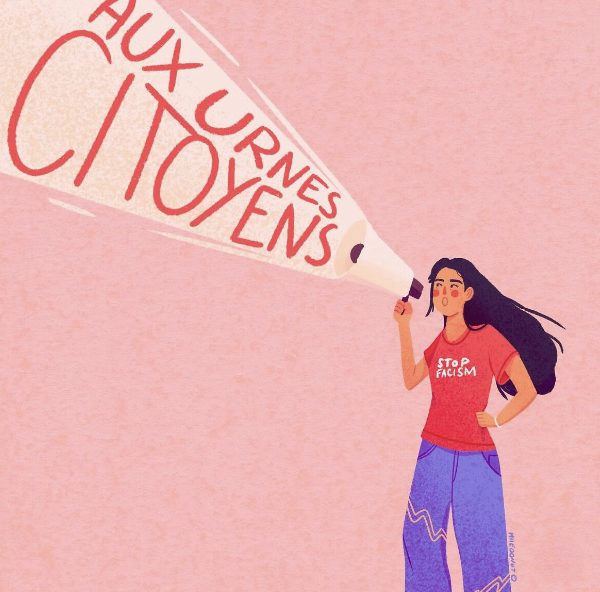

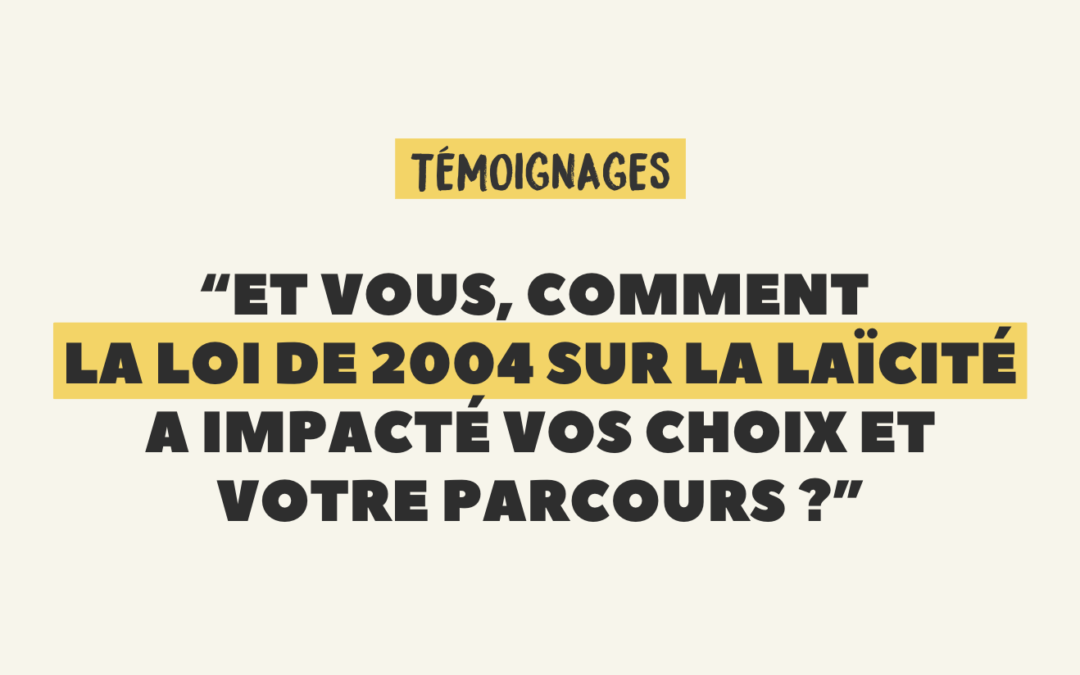
![[Communiqué] 20 ans plus tard, la loi de 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques a façonné une génération de féministes](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2024/03/Communique-Lallab-Muslim-Womens-Day-2024-Loi-2004-1.png)

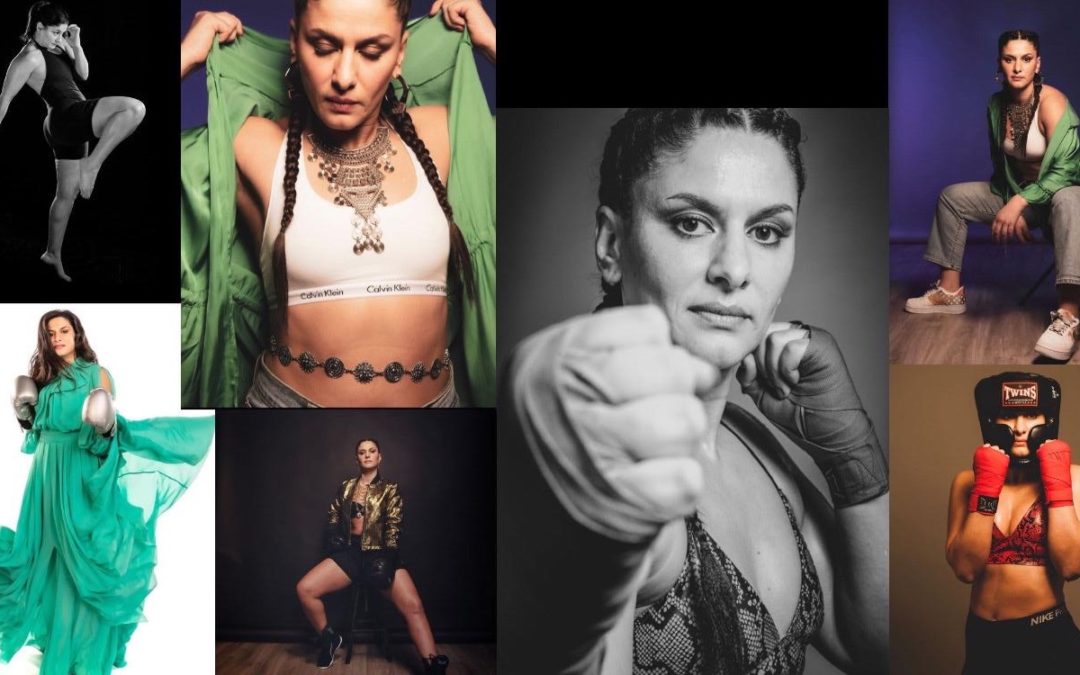

![[Communiqué] Notre silence ne nous protégera pas : les violences sexistes et sexuelles dans les milieux militants ou religieux ne doivent plus passer sous silence](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2021/03/Amani-Haydar-communiqué-lallab-violences-sexistes-et-sexuelles.png)


![[Communiqué] 8 mars 2020 : « Nous sommes fatiguées »](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2020/09/Village-des-féminismes-2-magazine.jpg)
![[Atelier d’écriture] Aucune fatalité](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2020/01/Sans-titre-1.png)


![[Communiqué] « Nos réalités comptent, mais qui en parle aujourd’hui ? Qui ça intéresse ? »](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2018/09/Laura-université-dété-du-féminisme-2018.png)
![[Communiqué] Pourquoi Lallab prendra la parole lors de l’Université d’été du féminisme ce vendredi 14 septembre 2018](https://www.lallab.org/wp-content/uploads/2018/09/Université-dété-du-féminisme.jpg)