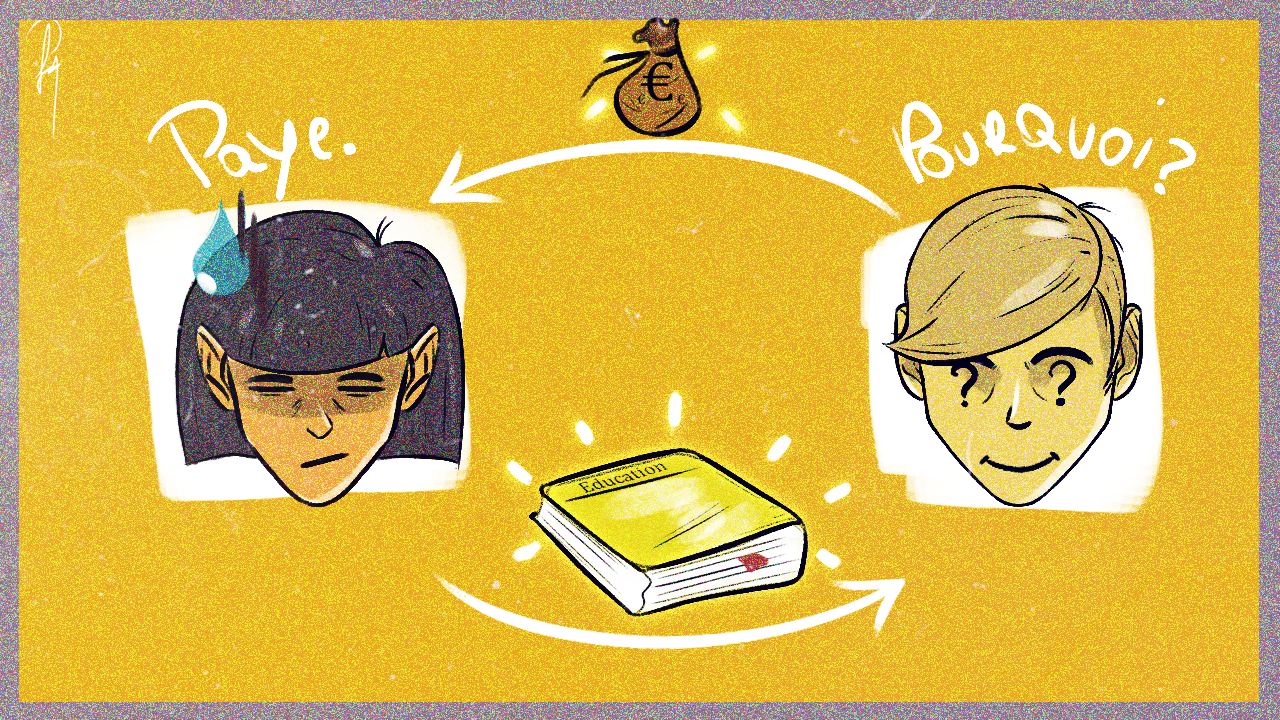Je me définis comme une personne « engagée », sur tous les pans de ma vie. Ce qui fait sens dans ma vie, c’est de rendre le monde et les gens meilleurs. J’imagine que c’est une certaine manière de me réparer aussi. Cela m’apaise de « faire le bien...