On dit que dans la vie, on a toujours un modèle, connu ou inconnu, que l’on suit par mimétisme et qui nous guide dans nos choix et nos engagements. Le mien c’est mon père. Cet homme a été pour moi une grande source d’inspiration et m’a permis de...


On dit que dans la vie, on a toujours un modèle, connu ou inconnu, que l’on suit par mimétisme et qui nous guide dans nos choix et nos engagements. Le mien c’est mon père. Cet homme a été pour moi une grande source d’inspiration et m’a permis de...
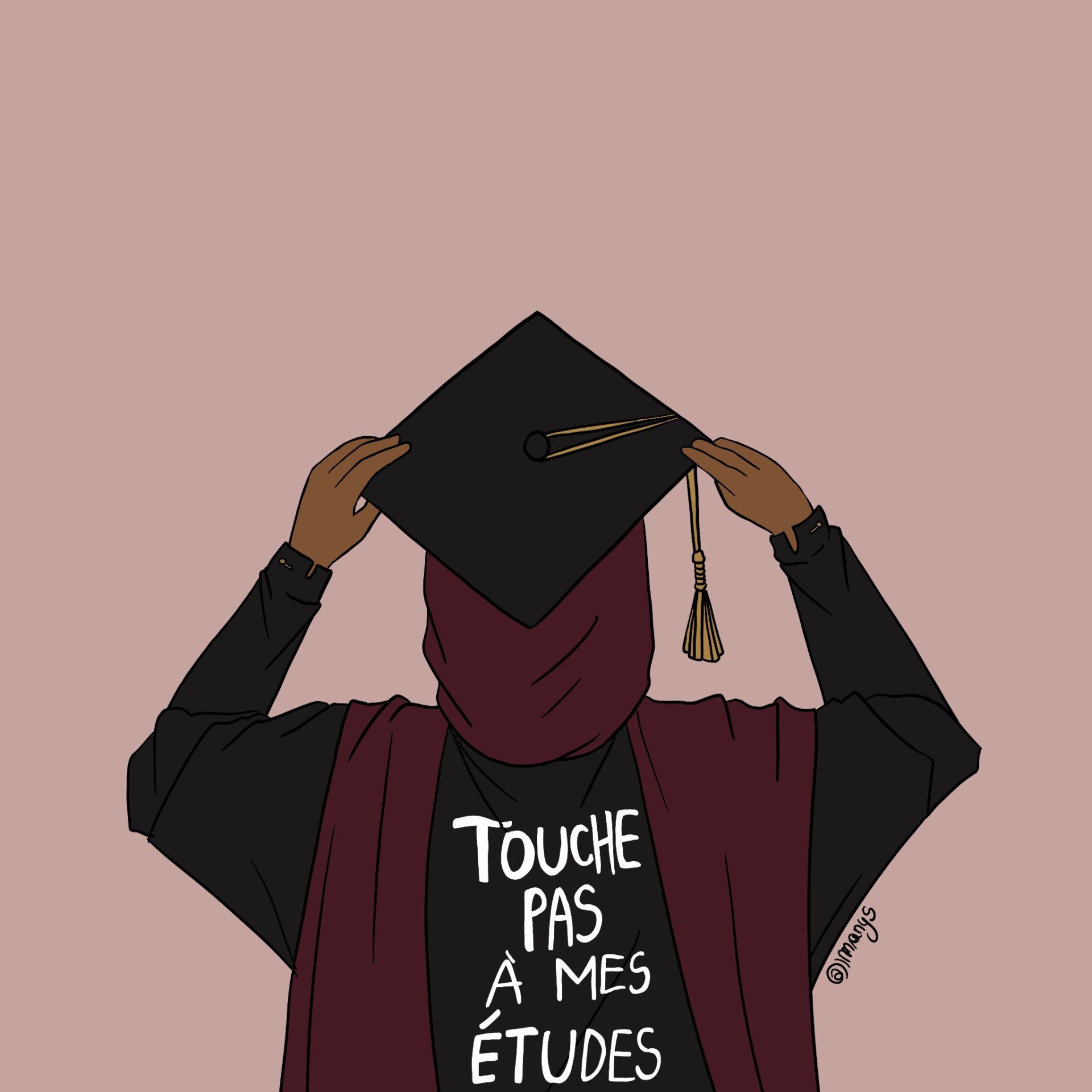
Dans le cadre du dossier sur le récit de lutte des étudiantes musulmanes en Belgique, une série d’entretiens consacrés aux partages d’expérience de collectifs, ayant initié et/ou participé au mouvement #HijabisFightBack, a été réalisée au mois de...
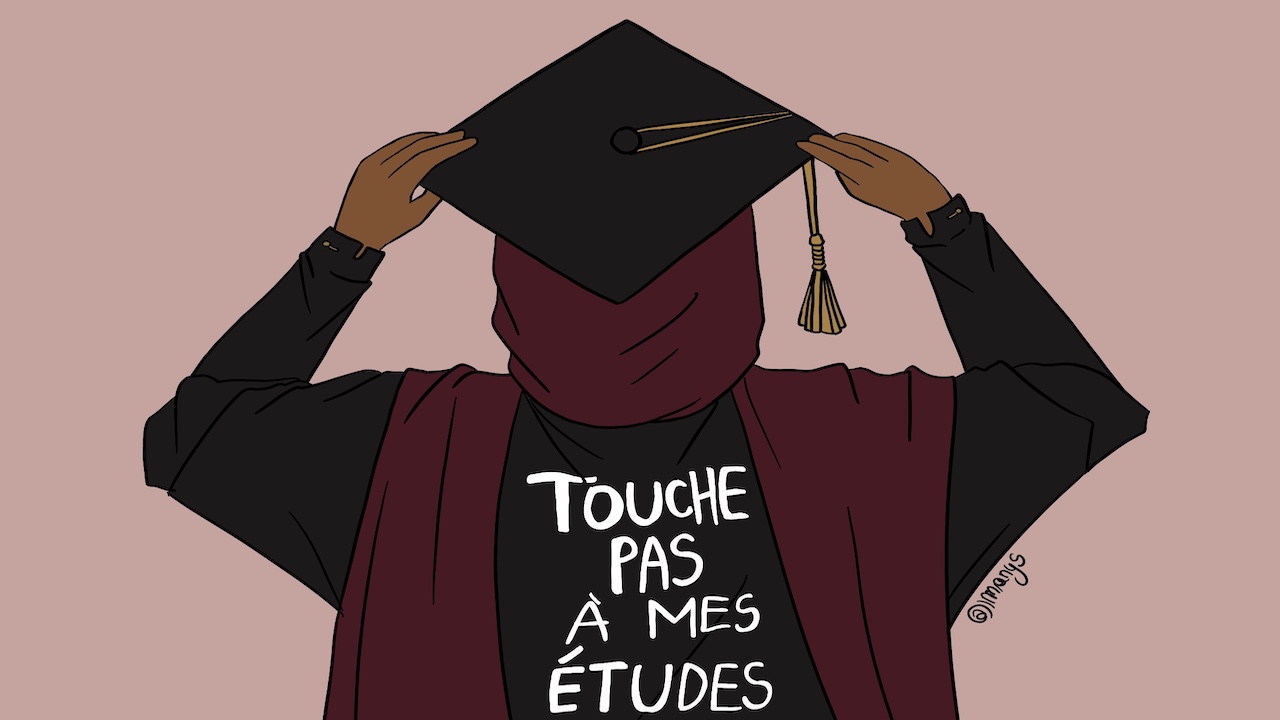
Dans le cadre du dossier sur le récit de lutte des étudiantes musulmanes en Belgique, une série d’entretiens consacrés aux partages d’expérience de collectifs ayant initié et/ou participé au mouvement #HijabisFightBack, a été réalisée au mois de...
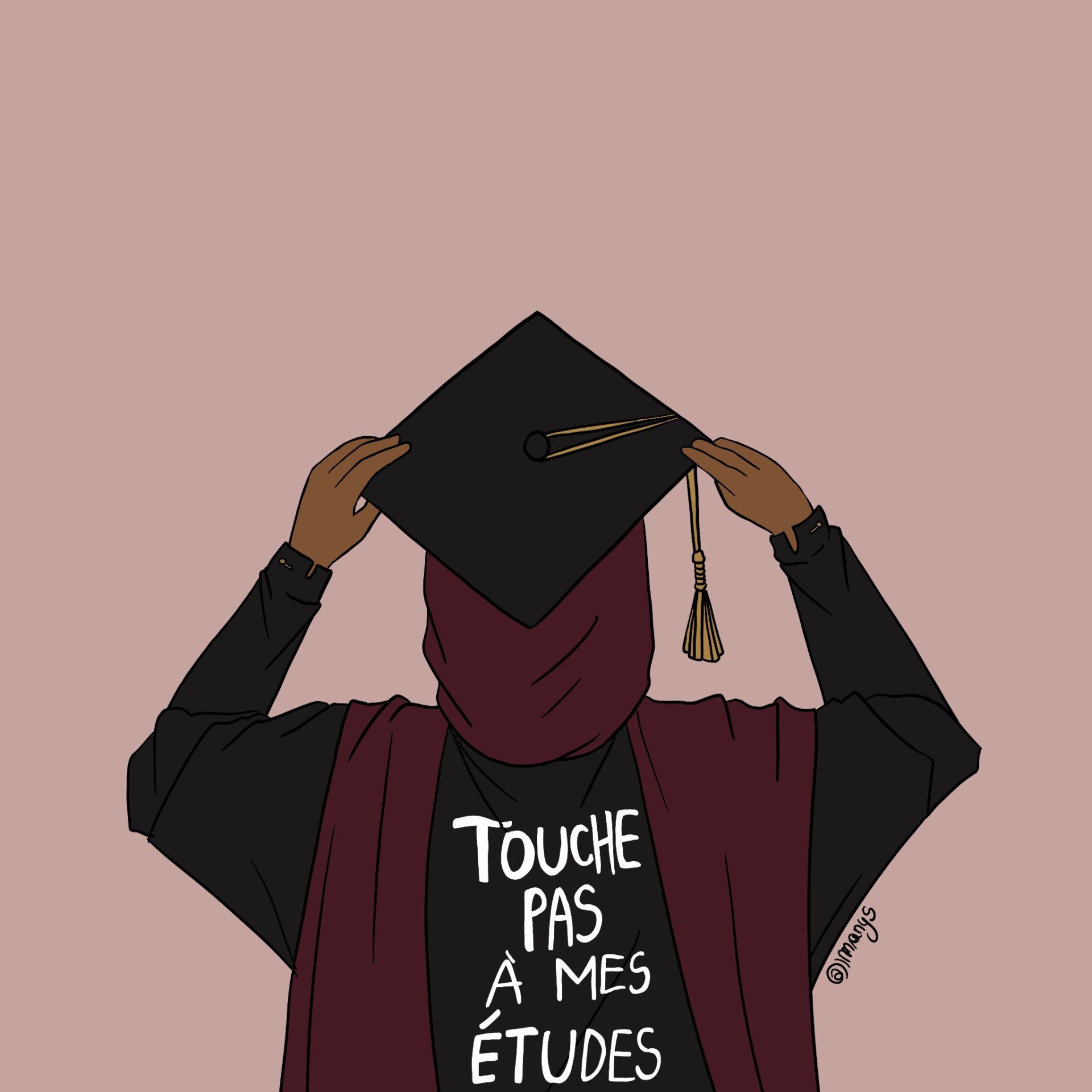
Dans le cadre du dossier sur le récit de lutte des étudiantes musulmanes en Belgique, une série d’entretiens consacrés aux partages d’expérience de collectifs ayant initié et/ou participé au mouvement #HijabisFightBack a été réalisée au mois de...

Paris, 31 janvier 2018. C’est une journée historique pour les Chibanis (“cheveux blancs” en arabe), ces travailleurs immigrés à la retraite. En effet, la Cour d’appel de Paris condamne en appel la SNCF dans l’affaire des 848 immigrés marocains qui...