L'association Lallab a eu l’honneur d’accueillir Malika Hamidi, chercheuse en sociologie à l'EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) et directrice du Think Tank European Muslim Network à Bruxelles, lors du 3ème Lallab Day,...


L'association Lallab a eu l’honneur d’accueillir Malika Hamidi, chercheuse en sociologie à l'EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) et directrice du Think Tank European Muslim Network à Bruxelles, lors du 3ème Lallab Day,...

Lorsque je partage mon vécu en tant que femme voilée, je suis souvent confrontée à des discours qui visent à délégitimer mes propos – en se concentrant sur la forme au détriment du fond, en me reprochant d’être parano, etc. Voici donc les 7...

Je commence à en avoir un petit peu marre d’user ma salive pour répondre encore et encore aux mêmes arguments contre le hijab. Alors toi qui voudrais entamer un énième débat ou me demander de justifier mes croyances et mes choix personnels, lis...
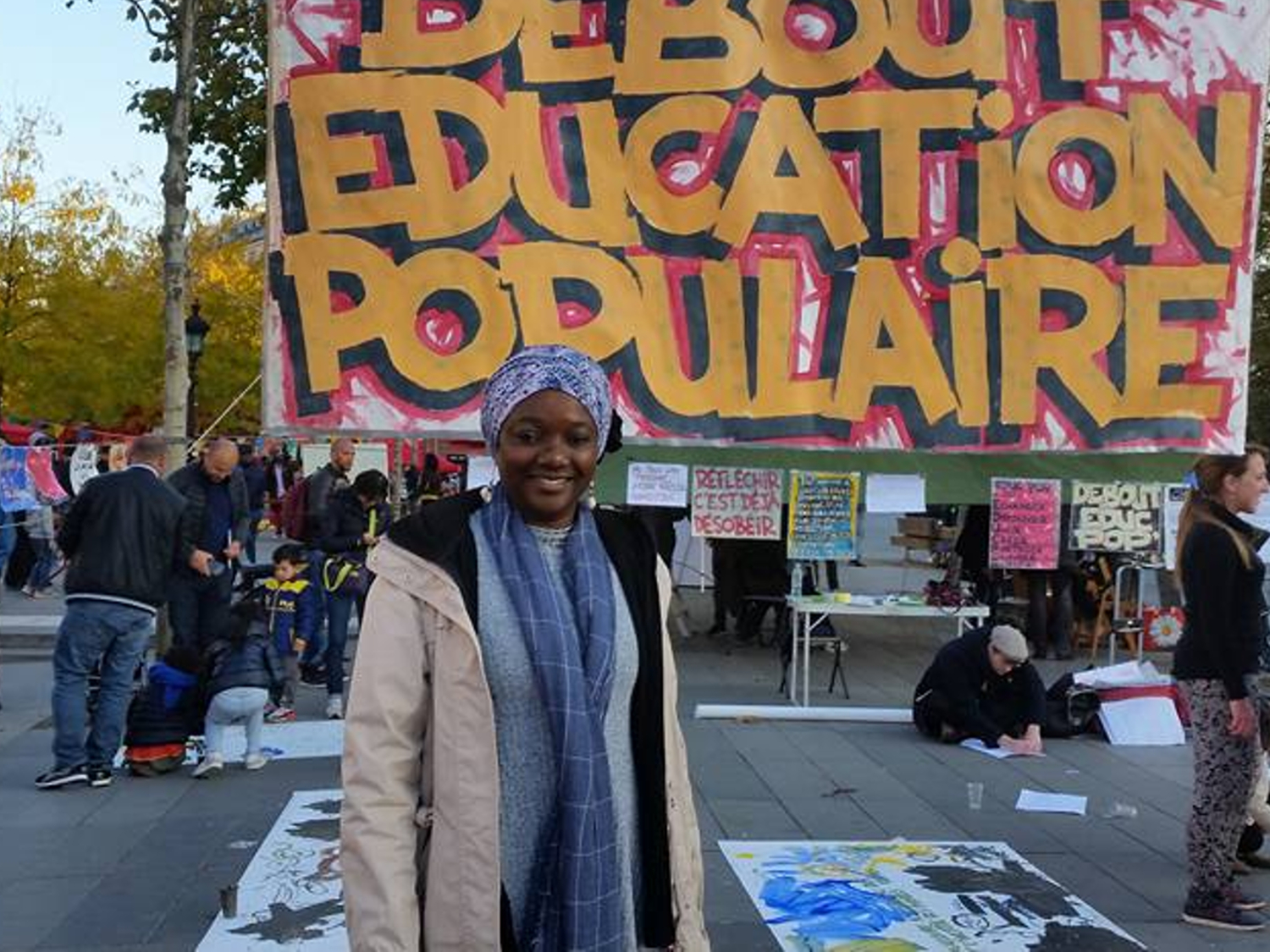
Quand on s'intéresse à la question des revendications de femmes, on s'aperçoit très vite que celles qui se définissent comme afroféministes sont aussi intrigantes qu’inspirantes, et surtout incontournables. En tant que femme musulmane non noire, je...

Artiste. Montréal – Canada

Médecin biologiste & directrice du Centre d’Etudes et de Recherches sur la question des Femmes dans l’Islam
Rabat – Maroc