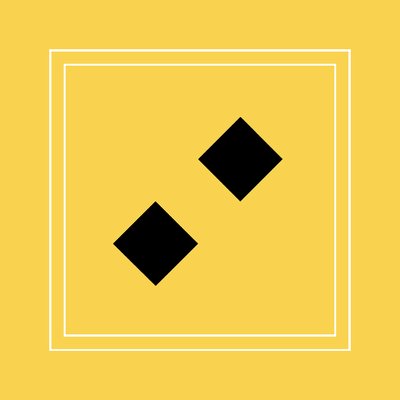Qu’est-ce que je vais faire après les élections présidentielles de 2017 ?
Cette question, je me la pose régulièrement. Je vois l’ombre menaçante du populisme, qu’il affiche ses couleurs ou les cache derrière un masque civilisé, avancer insidieusement sur mon pays. Et je sens mes forces diminuer à la même vitesse. Je vois les choix se réduire à des options encore pires que ce que je redoutais, et je crois que je ne serai pas capable d’encaisser le choc. J’ai le sentiment d’être déjà à bout, et chaque jour qui passe me prouve que les limites de l’intolérance peuvent toujours être repoussées.
Certains jours, comme aujourd’hui, j’ai l’impression d’être en ruines. Je ne sais plus où est passée la jeune femme à l’aise en société et se sentant parfaitement sereine avec ses multiples identités. J’ai le sentiment qu’en tant que femme musulmane portant le hijab, on m’ordonne de me mêler à la société, tout en faisant tout pour que j’aie envie de me tenir à l’écart.
L’appréhension a remplacé l’insouciance dans mes moments quotidiens les plus banals, et l’envie de fuir a remplacé la pensée naturelle que je poursuivrais ma vie dans le pays qui m’a vue grandir. La voix du jugement et des reproches est tellement présente au quotidien que je l’entends en permanence dans ma tête, résonnant des réactions que je peux prédire, des critiques que l’on fera en me lisant, en me voyant ou en m’écoutant.
Je crois que c’est le pire, ce sentiment que j’ai tellement intériorisé le rejet que je ne dispose même plus d’un espace de liberté au plus profond de ma conscience. C’est comme si toutes les personnes que j’entends et croise au quotidien s’étaient matérialisées en une espèce de voix réprobatrice, qui m’assène des reproches avant même qu’une personne extérieure ait besoin de les formuler. La critique tellement efficace qu’elle n’a plus besoin d’exister, remplacée par celle allègrement assurée par mon esprit lui-même.
Certes, je tente tant bien que mal de contourner les situations épineuses, de chercher une sagesse dans les confrontations et les dos tournés, de m’accrocher à mes idéaux d’une société inclusive. Mais je suis bien obligée de reconnaître que je suis à bout. Je suis épuisée de devoir sans cesse me justifier, de voir chaque jour de ma vie comme une source potentielle de rejets plutôt que d’opportunités. Exténuée de me voir reprocher ma « victimisation », mes « exagérations », ma « paranoïa » quand j’essaie d’alerter sur ce que je vis au quotidien, et que je retrouve tristement dans les récits de milliers de mes sœurs. Ereintée de constater que dans ma propre communauté, les discours d’exclusion sont parfois tellement bien intériorisés que c’est à moi qu’on attribue la responsabilité de ce dont je suis victime. Le problème, ce n’est pas l’exclusion que je subis, mais c’est que je n’aurais pas dû attirer l’attention, « provoquer ».
En 2017, en France, c’est épuisant d’être une femme.
C’est épuisant d’être racisée. Et c’est particulièrement épuisant d’être voilée.
Bien que la situation ne soit parfaite nulle part, les périodes que j’ai passées à l’étranger m’ont montré que ce que je considérais comme une « norme » que je retrouverais partout où j’irais, était en réalité une obsession hexagonale bien ancrée dans un passé colonial mal digéré.
Loin des débats et des législations visant à règlementer la manière dont une catégorie bien spécifique de femmes s’habille, j’ai découvert des endroits où les différences ne sont pas considérées comme des menaces à l’unité de la société, mais comme des singularités qui l’enrichissent de visions du monde variées.
Je me suis habituée au « luxe » (qui n’en est en réalité pas un) de pouvoir être moi-même, libérée de toute crainte que le bout de tissu que je porte sur la tête m’attirera un comportement hostile, froid, méprisant ou haineux de la part de la caissière, du pharmacien, de la chargée de recrutement, du voisin, de la professeure, du journaliste, de l’inconnue dans la file d’attente, du serveur, de l’employée administrative, du plombier, et parfois même de ceux et celles qui étaient mes ami.e.s.
J’ai pris conscience que si quelqu’un me rejetait à cause de l’un des multiples aspects de mon identité, ou s’éloignait de moi à cause d’un choix qu’il.elle désapprouvait, cela ne signifiait pas que j’étais coupable et que je devais changer.
Je me suis reconstruite dans le rapport apaisé des autres aux signes extérieurs de ma croyance, dans les échanges basés sur une saine curiosité, et dans l’acceptation que ma foi différente suppose parfois des pratiques différentes, sans que les autres aient besoin que je les justifie et les défende.
Je me suis reposée dans le confort à la fois rassurant et enthousiasmant de pouvoir explorer mes capacités et les talents que je pouvais développer, libérée des exclusions dues à mon hijab et des craintes anticipées. J’ai rechargé mes batteries, et j’ai bien fait, parce que je n’aurais jamais pu être assez préparée à la claque que je m’apprêtais à prendre en rentrant en France.
Choc culturel inversé
J’avais presque fini par oublier que dans mon propre pays, on pouvait me demander d’enlever mon foulard au nom de ma liberté, du droit des femmes à s’habiller comme elles l’entendent, ou encore d’un principe qui garantit la liberté de chacun.e de croire ou de ne pas croire, et d’exprimer ses éventuelles croyances comme il ou elle le souhaite. J’avais aussi oublié qu’en décidant de rester fidèle à mes convictions, je me condamnais à des perspectives personnelles et professionnelles limitées.
Peu après mon retour, en pleine polémique sur le burkini, une tentative de lecture au bord de la plage a vite fait de me rappeler ma place dans la chaîne alimentaire. Le sel des larmes sur mes joues s’est mêlé à celui de l’air marin quand la succession de commentaires, d’insultes et de nuisances physiques a fait revenir dans ma gorge le goût amer de l’humiliation.
Et ma vie quotidienne s’est chargée d’illustrer l’efficacité du supplice de la goutte d’eau, où l’aspect inoffensif des gouttes éclipse la souffrance que provoque leur chute répétée, au même endroit et à des intervalles beaucoup trop rapprochés.
Je sais que « tout le monde n’est pas comme ça », que beaucoup de mes concitoyen.ne.s ne remettent pas en cause mon appartenance à la communauté nationale, et qu’ils.elles me considèrent comme aussi Française qu’eux.elles. Mais même parmi celles et ceux qui s’indignent des discriminations que nous vivons, certain.e.s sont encore enfermé.e.s dans leurs jugements et se sentent investi.e.s de la mission de nous « libérer ». Surtout, ils.elles tombent souvent dans le piège de stigmatiser et exclure les personnes, au lieu des comportements avec lesquels ils.elles sont en désaccord.
En attendant, les anecdotes s’accumulent, les rejets sont de plus en plus récurrents et un silence assourdissant les entoure, comme sur un ring où, déjà sonnée et chancelante, je tenterais tant bien que mal d’esquiver les coups. Ces temps-ci, une citation de Martin Luther King résonne particulièrement dans ma tête :
A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis.
Alors que faire ?
Depuis que je suis rentrée, je ne cesse de me demander pourquoi je devrais sacrifier mon bien-être et ma tranquillité d’esprit simplement parce que « c’est mon pays ». Pour montrer que ma place est bien ici et que j’ai quelque chose à apporter à la société, même si je m’épuise en le faisant, même si j’y laisse des plumes, même si j’en perds mon estime de moi et ma santé.
Je me demande pourquoi je donnerais tout à mon pays alors qu’il me considère comme une nuisance, et que je pourrais apporter mes compétences à un pays d’adoption qui me donnerait au moins l’occasion de les exprimer. J’aspire seulement à être dans un endroit où je pourrai quitter ce casque mental qui fait que je me censure pour éviter les occasions de me prendre des coups.

Crédit : Banksy
Je me demande de plus en plus pourquoi je resterais dans un pays où on me renvoie sans cesse à des origines et des appartenances plus ou moins lointaines et fantasmées. Dans le café où je voulais me reposer après la Marche républicaine du 11 janvier 2015, le serveur m’a superbement ignorée, et le commentaire de mes voisins m’a violemment rappelé que même lorsque je pensais faire corps avec le reste de la nation, je restais séparée par une frontière symbolique :
Ils vous ont peut-être prise pour une des terroristes !
Leur rire m’est resté en travers de la gorge et m’aurait étranglée.
Je me demande si je dois rester pour contribuer à faire avancer les choses, ou si, quoique l’on fasse, nos enfants seront encore perpétuellement renvoyés à un « ailleurs » réel ou imaginaire, d’où on nous aurait sauvé.e.s et où nous n’avons « qu’à rentrer » si nous avons des revendications à exprimer – non pas parce que nous n’aimons pas ce pays, mais justement parce que nous l’aimons.
Je me demande si nos enfants seront, eux aussi, émus aux larmes quand leurs coutumes seront valorisées, présentées ni comme folkloriques ni comme arriérées, leur faisant réaliser à quel point ce genre de représentation était rare et leur avait manqué.
Je me demande si on les félicitera aussi pour leur maîtrise de la langue française, et s’ils seront perplexes qu’on les complimente pour leur connaissance de leur propre langue maternelle. S’ils entendront les mêmes questions, remarques, quolibets. Si on leur reprochera leur « manque d’humour » quand ils n’auront pas le cœur à rire à certaines « blagues ».
S’ils hausseront les épaules d’un air résigné ou seront emplis de révolte quand ils apprendront que leur dossier a été écarté pour un énième emploi ou logement en raison de leur nom, de leur couleur de peau, de leur barbe ou de leur foulard, pendant que le reste de la société leur criera d’arrêter de voir le mal partout.
Je me demande combien de générations il faudra pour qu’on ne soit plus considéré.e.s comme des étranger.e.s, et si mes arrière-petits-enfants entendront, ou pire, prononceront encore des phrases lourdes de sens, où les mots « Français.e » et « Arabe/Asiatique/Noir.e » seront utilisés comme des dénominations distinctes et opposées.
J’ai l’impression d’écrire un dernier mot à un partenaire que je m’apprête à quitter avec regret, en essayant de faire taire cet espoir peu raisonnable de voir enfin une réaction de sa part pour me retenir. La France sera toujours mon pays, mais je suis épuisée de devoir choisir entre mes identités ou de devoir les prouver, et il est peut-être temps que je renoue avec cette vieille tradition familiale d’aller voir si le soleil brille plus sous d’autres latitudes.
Diffuse la bonne parole