Pour Halloween, sorcières, fantômes et zombies seront de sortie... mais aussi indiens, danseuses orientales ou encore geishas. C’est une fête où l’on se déguise en ce que l’on souhaite et personne ne nous en tient rigueur, sauf que, même si...


Pour Halloween, sorcières, fantômes et zombies seront de sortie... mais aussi indiens, danseuses orientales ou encore geishas. C’est une fête où l’on se déguise en ce que l’on souhaite et personne ne nous en tient rigueur, sauf que, même si...
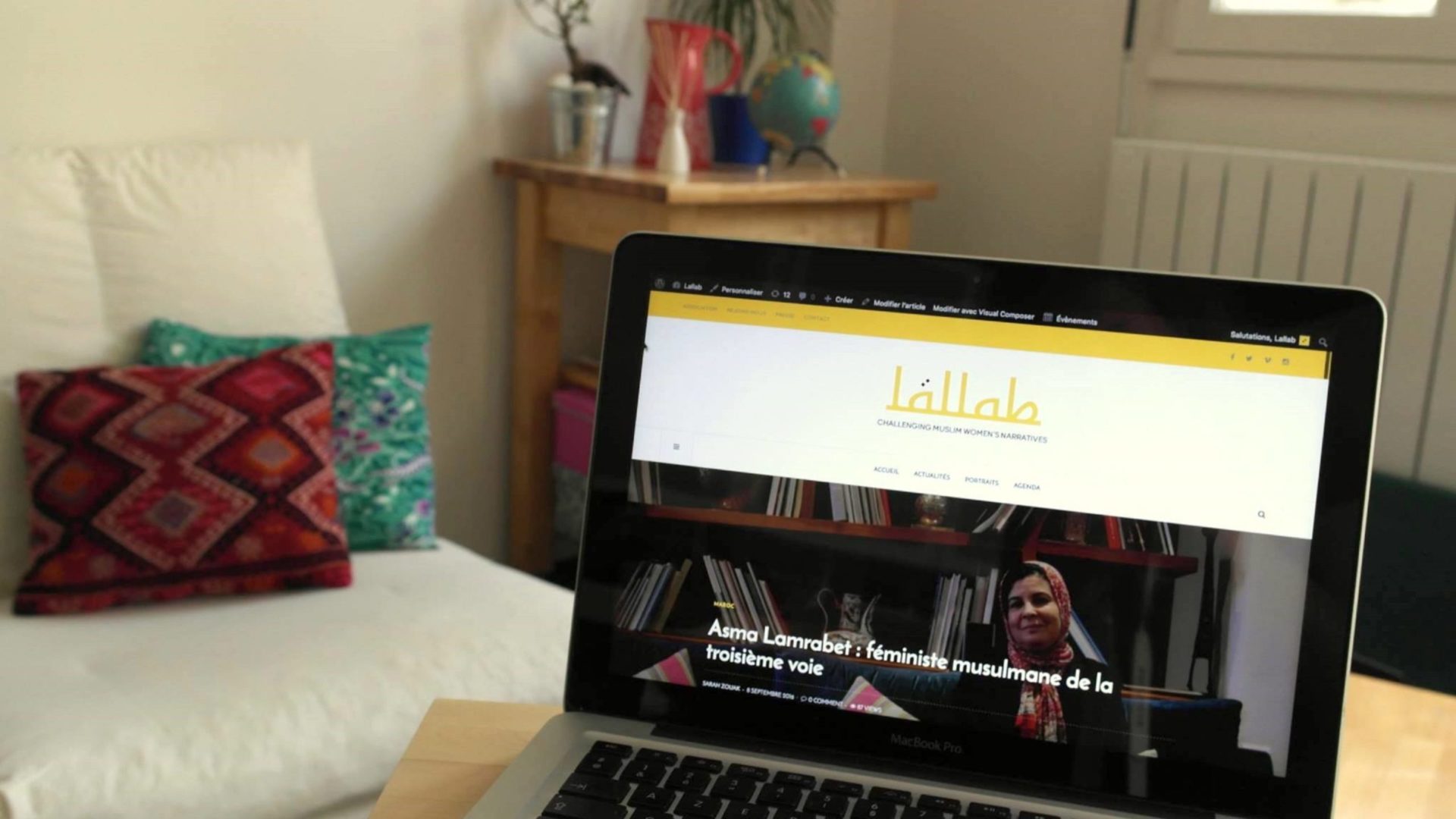
Aujourd’hui, en France, en 2016, comme l’ont d’ailleurs très bien illustré une fois de plus les nombreuses polémiques de cet été, on en est encore à expliquer aux femmes musulmanes comment elles doivent penser, se vêtir et vivre leurs vies. On...