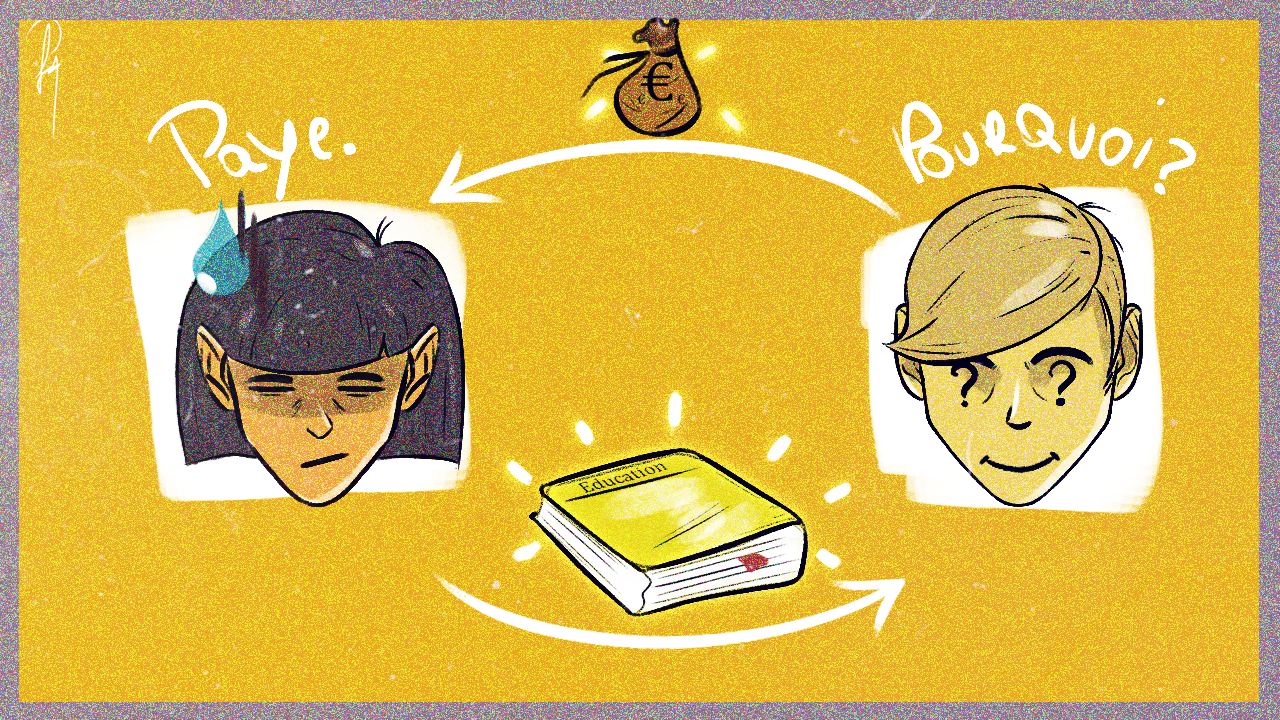Depuis toute petite, j’ai toujours aimé argumenter et débattre. Je n’ai jamais supporté de m’entendre asséner des vérités supposément absolues avec lesquelles je n’étais pas d’accord. Cela a persisté avec ma conscientisation et mon intérêt pour la...